Sinologie
La sinologie est l'étude de la Chine, consistant le plus souvent en une combinaison des méthodologies, théories et concept occidentaux en chinois.
Recherche sur Google Images :
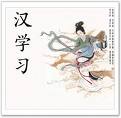
Source image : noblesavoir.com Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Définitions :
- Étude de la langue et de l'écriture des Chinois; connaissance des mœurs et de l'histoire de ce peuple (source : fr.wiktionary)
La sinologie est l'étude de la Chine, consistant le plus souvent en une combinaison des méthodologies, théories et concept occidentaux en chinois. Certains estiment que son apparition remonte aussi loin que Marco Polo au XIIIe siècle. L'étude systématique de la Chine remonte au XVIe siècle, lorsque les missionaires jésuites, surtout Matteo Ricci, Ferdinand Verbiest, Antoine Thomas et d'autres tentèrent d'introduire le christianisme en Chine. Ainsi, les premières études sinologiques traitent fréquemment des aspects de la compatibilité du christianisme avec la culture chinoise.
Le Siècle des Lumières est une période de grande curiosité intellectuelle alimentée par les explorations et découvertes de nouveaux mondes. Des récits et des lettres - entre autres celles qui furent rassemblée dans la grande collection des Lettres édifiantes et curieuses - circulaient et ouvraient l'Europe aux autres cultures. L'immense empire de la Chine fascinait tout spécifiquement et des'sinologues' (un grand mot pour le travail fait à l'époque!) commençèrent à populariser la philosophie, l'éthique, les concepts légaux et l'esthétique chinoise en Occident. Bien que fréquemment caricaturaux et incomplets, ces travaux ont contribué à un certain intérêt du public vis-a-vis des "chinoiseries", et alimenté des débats comparatifs. À cette époque, la Chine était fréquemment décrite comme un royaume éclairé.
Voltaire, grand lecteur des Lettres édifiantes... , a manifesté son intérêt pour le pays dans sa pièce, L'orphelin chinois . Leibniz, l'inventeur du calcul différentiel, était particulièrement intéressé par la philosophie chinoise et surtout le Yi Jing, où il voyait une démonstration idéale de la suite des nombres premiers. Il a aussi puisé dans le chinois l'idéal d'une langue universelle, de nature mathématique - idée immédiatement démentie par une analyse basique de la langue.
En 1795, l'école des Langues orientales Vivantes fut créée à Paris en 1796 par la Convention. En France, Jean-Baptiste Du Halde qui lui-même n'avait jamais visité la Chine, publia en 1725 une Description de la Chine (4 volumes avec cartes) qui était beaucoup basée sur les lettres reçues de confrères jésuites. Ce livre fit autorité et fut rapidement traduit en quatre langues étrangères.
Au XVIIe et XVIIIe siècles, d'autres missionaires tels que James Legge (1815-1897) ont milité pour l'établissement de la sinologie comme discipline universitaire. En 1837, Samuel Kidd (1797-1843) devint le premier professeur de Chinois en Angleterre. Les sinologues devinrent progressivement plus nombreux que les missionaires, et la sinologie s'est établie comme une discipline consistante au XXe siècle. Elle peut avoir une influence politique, avec des sinologues agissant comme conseillers, tels John Fairbank aux États-Unis.
Durant la guerre froide, en France, Simon Leys a vivement critiqué les sinologues, dont l'engagement politique - à droite ou à gauche - oblitérait de façon grotesque la validité scientifique de leurs analyses. Il ridiculise ainsi ces spécialistes qui nous expliquent la Chine, surtout Alain Peyrefitte.
Au XXIeme siècle, la sinologie est une discipline nommée à prendre de plus en plus de poids, compte tenu de l'importance économique et stratégique croissante de la République populaire de Chine.
Sinologues
Italie
- Matteo Ricci (1552-1610) - Premier Européen à bien connaitre la langue et culture chinoise.
Angleterre
|
|
France
- Jean-Baptiste Du Halde (1674-1743) - Auteur du premier grand ouvrage de référence sur la Chine : Description de la Chine' (4 volumes).
- Arcade Huang (1679-1717) - chinois. Premier sinologue français du fait de ses études passées en Chine. Débute un dictionnaire et une grammaire du chinois.
- Étienne Fourmont (1683-1745) - Élève du précédent. Étend le dictionnaire Franco-chinois.
- Jean-Pierre-Abel Rémusat (1788-1832)
- Stanislas Julien (1797-1873)
- Séraphin Couvreur (1835-1919)
- Henri Maspero (1883-1945)
- Marcel Granet (1884-1940)
- René Grousset (1885-1952) - Historien orientaliste, plusieurs ouvrages historique sur la Chine et les empires limitrophes.
- Robert des Rotours (1891-1980)
- Paul Demiéville (1894-1979)
- Rolf Stein (1911-1999) - Professeur au Collège de France
- Yves Hervouet (1921-1999) - Chercheur et professeur de chinois, Secrétaire général du XXIXe Congrès Mondial des Orientalistes
- Jacques Gernet (n. 1921) - Œuvre principale : "Le monde chinois".
- Jean-Luc Domenach (n. 1945)
- François Jullien (n. 1951)
- Marie Holzman (n. 1953)
- François Cheng (n. 1929)
- Jean-Philippe Béja
Belgique
Allemagne
- Christian Mentzel (1622–1701)
- Otto Franke (1863-1946)
- Richard Wilhelm (1873-1930)
- Wolfgang Franke (1912-2007)
Japon
|
|
Russie
- Nikita Yakovlevich Bichurin (1775-1853)
- Pyotr Ivanovich Kafarov (1817-1878)
Etats-Unis
|
|
Autres
- Jean François Billeter (1939-), suisse
- Jerome Ch'en (1919-), canadien
- Rafe de Crespigny (1936-), australien
- Jan Julius Lodewijk Duyvendak (1889-1954), néerlandais
- Bernhard Karlgren, suédois
- Simon Leys, belge
- Erwin Ritter von Zach, autrichien
- Edwin G. Pulleyblank, canadien
- Göran Malmqvist, suédois
- Léon Vandermeersch
- Wang Gungwu, singapourien
- Jaroslav Prusek, tchèque
- Robert Van Gulik
- Étienne Balazs, hongrois
- Ferenc Tőkei, hongrois
Recherche sur Amazone (livres) : |
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 23/11/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.


 Accueil
Accueil Recherche
Recherche Début page
Début page Contact
Contact Imprimer
Imprimer Accessibilité
Accessibilité